1. Fonctionnement optique
Les rayons lumineux doivent d'abord traverser les milieux transparents de l'œil, la cornée et le cristallin, qui sont l'équivalent d'une lentille convergente permettant la formation de l'image d'un objet sur la rétine. Pour les objets proches une mise au point est réalisée grâce au cristallin selon les principes de l'optique classique l'image d'un point situé sur le coté droit de l'œil va se former dans la partie gauche de la rétine, et inversement pour un point situé a gauche.
L'estimation de la taille d'un objet et de la distance à laquelle il est placé résulte tout d'abord d'un phénomène optique simple. En effet si un objet est plus grand qu'un autre, la taille de l'image sur la rétine est plus grande. Si la distance se réduit entre l'objet et l'observateur, la taille de l'image grandit. Une augmentation de la taille de l'image rétinienne est donc en général, interprétée par le cerveau comme un rapprochement de l'objet.
Les bâtonnets mesurent environ 0,06 millimètres de long et 0,25 millimètres d'épaisseur. Les cônes sont plus courts et plus larges. Il y a environ 120 millions de bâtonnets dans un oeil. Ils fonctionnent lorsque la lumière est faible et perçoivent le noir et le blanc.
Il y a environ 7 millions de cônes dans chaque oeil. Ceux-ci fonctionnent en pleine lumière. Ils permettent de voir les couleurs. Les cônes contiennent un pigment appelé rhodopsine, qui est décomposé et décoloré à la lumière. Ce procédé de décomposition crée un potentiel électrique qui transforme l'énergie lumineuse en impulsion nerveuse, cette impulsion est transmise au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Ces impulsions sont interprétées par le cortex visuel pour nous permettre de voir.
2. Voies optiques
On appelle voie optique la succession de neurones qui commence dans l'épaisseur de la rétine et se termine sur le cortex cérébral. Le nerf optique, né de neurones de la rétine, s'éloigne du globe oculaire et se termine au niveau d'une structure en forme de X, le chiasma optique, ou se croisent une partie des fibres de chacun des deux nerfs. Après le nerf optique et le chiasma, la voie se continue par la bandelette optique, passe par différents centres nerveux, et se termine sur le lobe occipital de l'hémisphère cérébrale du même coté.
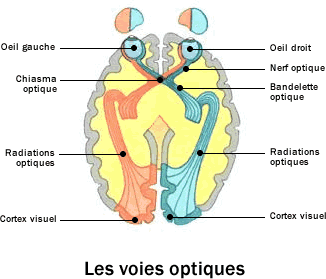
3. Rôle du cerveau
Le cortex qui tapisse les hémisphères reçoit les informations visuelles et réalise les analyses simples ou complexes. Des neurones issus des différents centres nerveux interposés sur le trajet des voies optiques, dans l'encéphale, assurent la liaison avec d'autre régions du système nerveux. Des connections existent, par exemple, avec les centres nerveux commandant les muscles oculomoteur. Le cerveau assure la fonction de vision binoculaire qui consiste à créer une image définitive a partir de deux images rétiniennes. Cette fonction intervient en particulier dans la réception du relief et de la profondeur. En effet, dans le cas des objets proches, les deux yeux ne donnent pas exactement la même image. L'homme est capable de faire converger ses deux yeux sur un objet isolé et d'obtenir une image et une vision stéréoscopique. Le principe de la vision stéréoscopique, exploité par les stéréoscopes, est fondé sur cette utilisation des deux images prises selon deux angles légèrement différents. Ces images sont comparées et fusionnées au niveau des centres visuels cérébraux pour former une image tridimensionnelle unique. Dans le cas des objets plus lointains ou de la vision avec un seul œil, la perception de la profondeur est fondée sur trois éléments :
_ L'estimation des tailles relatives et des distances de chacun des objets d'un groupe.
_
La différence d'accommodation du cristallin nécessaire pour voir net tel ou tel de ces objets.
_
L'interruption du contour d'un objet par un autre objet.